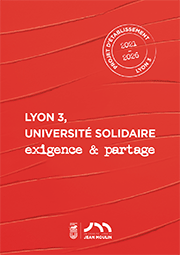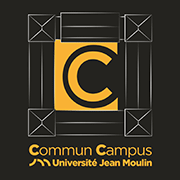AccueilRechercheProgrammes et productions scientifiquesThèsesThèses soutenuesThèses soutenues - 2025
-
Partager cette page
- Recherche,
- Sciences sociales,
BOYARD Maureen
L’économie de la faim. Vivre et penser la faim et les privations alimentaires dans l’Occident chrétien (milieu du VIIIe siècle – début du XIIe siècle)
Thèse en Sciences Sociales, soutenue le 04/04/2025.
De l’avènement des Carolingiens au début du XIIe siècle, la faim et les privations de nourriture, volontaires ou non, dans l’Occident chrétien révèlent les fragilités des économies ; elles sont l’objet de réflexions politiques ; elles sont au c?ur de la vie religieuse via le je?ne ; la médecine fait à la fois de l’appétit un élément diagnostic et du je?ne un moyen thérapeutique. L’hypothèse de travail de cette thèse est que ces différents aspects de la faim doivent être compris comme un tout cohérent, qui témoigne de l’influence réciproque des conditions matérielles d’existence et des représentations culturelles liées aux pénuries. Cette thèse mobilise à la fois des analyses quantitatives et qualitatives. L’approche quantitative donne une vision des évolutions générales des usages des termes liés à la faim en fonction des différentes natures des sources. Elle prend la forme d’une étude lexicométrique à partir des Monumenta Germaniae Historica, de la Library of Latin Texts, de l'Aristoteles Latinus Database et de l’Archive of Celtic-Latin Literature. Elle débouche sur une analyse plus fine des dynamiques propres à chaque sous-corpus (textes législatifs, hagiographiques, sermons, sources narratives, sources normatives, etc.). L’approche qualitative mobilise principalement les documents écrits, avec le complément de sources iconographiques et archéologiques. Le premier temps de l’analyse porte surtout sur les textes exégétiques, médicaux et narratifs afin d’identifier les représentations et les valeurs attachées à la faim, au je?ne et aux famines. Il délimite les critères de légitimité ou de disqualification du désir alimentaire, considéré, selon les cas, comme une faim légitime ou comme une gourmandise peccamineuse. Dans un deuxième temps, le je?ne est étudié en tant que pratique sociale qui scande le temps des sociétés médiévales. Les réformes des calendriers et pratiques de je?ne sont mises en relation avec l’ambition manifestée par les pouvoirs, notamment impériaux et pontificaux, de fixer les normes de comportement. Dans un troisième temps, la définition des crises alimentaires conduit à distinguer les périodes où une faim ordinaire touche régulièrement les plus pauvres et la période considérée par les médiévaux comme une crise. Nous y défendons l’idée que la crise est avant tout définie par la subversion de l’ordre social, plus encore que par la surmortalité. Dans un quatrième temps, nous terminons donc par une analyse des modèles de comportement qui sont proposés aux différentes catégories de population dans les contextes de crise alimentaire ou de faim ordinaire. Nous y analysons à chaque fois les comportements promus et condamnés, qu’il s’agisse des pauvres, des élites la?ques ou des ecclésiastiques. Une attention particulière est portée aux modèles épiscopaux. En interrogeant ces corpus très variés sous le prisme de la faim et de la privation alimentaire, la faim est constituée en objet historique à part entière, dans le cadre de l’Occident chrétien du Moyen ?ge central. La thèse examine la fa?on dont ces phénomènes ont été per?us et conceptualisés dans ces sociétés où la nourriture est rare et où la pénurie n’est pas subie en permanence mais est toujours pensée comme une possibilité et un risque.
Mots-clés : Faim ; Je?ne ; Famine ; Moyen ?ge
From the advent of the Carolingians to the beginning of the twelfth century in the Christian West, hunger and food deprivation – whether voluntary or not – highlighted the fragility of economies, were the subject of political reflection as well as an integral part of religious life through fasting, and were taken into account by medicine, which viewed appetite as a diagnostic element and fasting as a therapeutic practice. This thesis argues that these different aspects of hunger should be understood as a coherent whole, reflecting the reciprocal influence of living conditions and cultural representations linked to food shortage. This thesis draws on both quantitative and qualitative analyses. The quantitative approach offers an overview of general changes in the use of hunger-related terms depending on the various types of sources. It takes the form of a lexicometric study based on the Monumenta Germaniae Historica, the Library of Latin Texts, the Aristoteles Latinus Database and the Archive of Celtic-Latin Literature. This leads to a more detailed analysis of the dynamics specific to each sub-corpus (legislative texts, hagiographies, sermons, narrative sources, normative texts, etc.). The qualitative approach relies primarily on written documents, supplemented by iconographic and archaeological sources. The analysis first focuses on exegetical, medical, and narrative texts to identify the representations and values linked to hunger, fasting, and famine. It outlines the criteria for either legitimizing or disqualifying desire for food, which, depending on the context, is seen as either legitimate hunger or sinful gluttony. Secondly, fasting is examined as a social practice that sets the rhythm of life in medieval societies. Reforms to fasting calendars and practices are linked to the ambitions of those in power – particularly the imperial and papal authorities – to establish standards of behaviour. Thirdly, the definition of food crises prompts us to distinguish between periods when ordinary hunger consistently affected the poorest, and those considered by the medieval authors as true crises. We argue that a crisis is primarily defined by the subversion of social order, rather than by excess mortality. In the fourth section, we conclude with an analysis of the behavioural models proposed to the different categories of population in the context of either a food crisis or ordinary hunger. In each case, we examine the behaviours that were promoted and those that were condemned, whether they be that of the poor, the secular elites, or ecclesiastics. Particular attention is given to episcopal models. By examining the diverse types of sources through the prism of hunger and food deprivation, hunger is established as a historical object in its own right, within the context of the Christian West during the central Middle Ages. The thesis explores how these phenomena were perceived and conceptualised in societies where food was scarce, and food shortage was not a constant reality but was constantly thought of as a possibility and a risk.
Keywords: Hunger ; Fasting ; Famine ; Middle ages
Direction de thèse : Mme ISAIA Marie-Céline et M. MAZEL Florian
Membres du jury :
- Mme Marie-Céline ISAIA, Professeure des universités, Université Jean Moulin Lyon 3, France, Co-directrice de thèse
- M. Florian MAZEL, Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France, Co-directeur de thèse
- Mme Isabelle ROSE, Professeure des universités, Université Rennes 2, France, Rapporteure
- M. Alexis WILKIN, Professeur, Université Libre de Bruxelles, Belgique, Rapporteur
- Mme Laurence MOULINIER-BROGI, Professeure des universités, Université Paris Nanterre, France, Examinatrice
- M. Charles WEST, Professeur, Université d'?dimbourg, Ecosse, Examinateur
Présidence du jury : Mme MOULINIER-BROGI Laurence